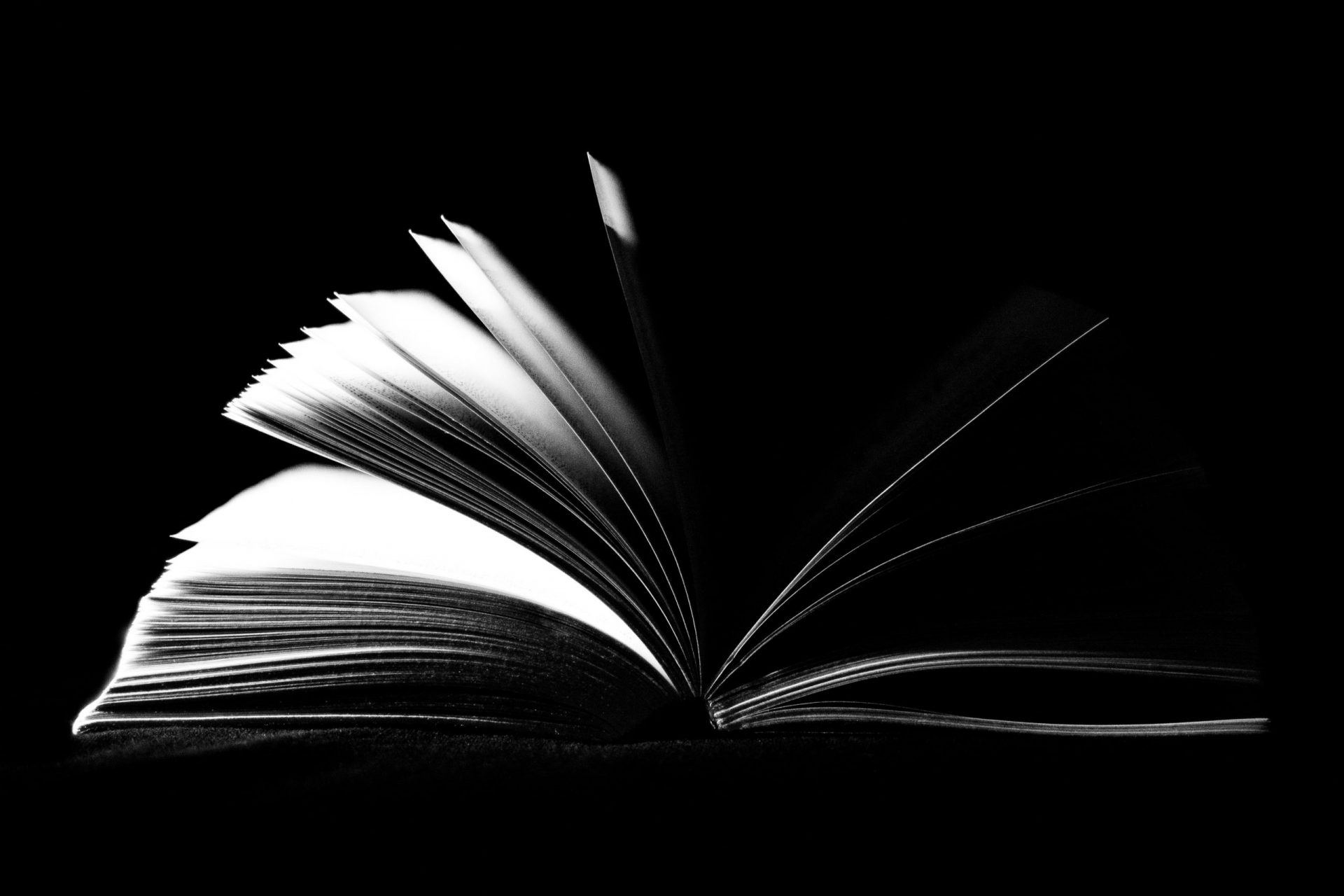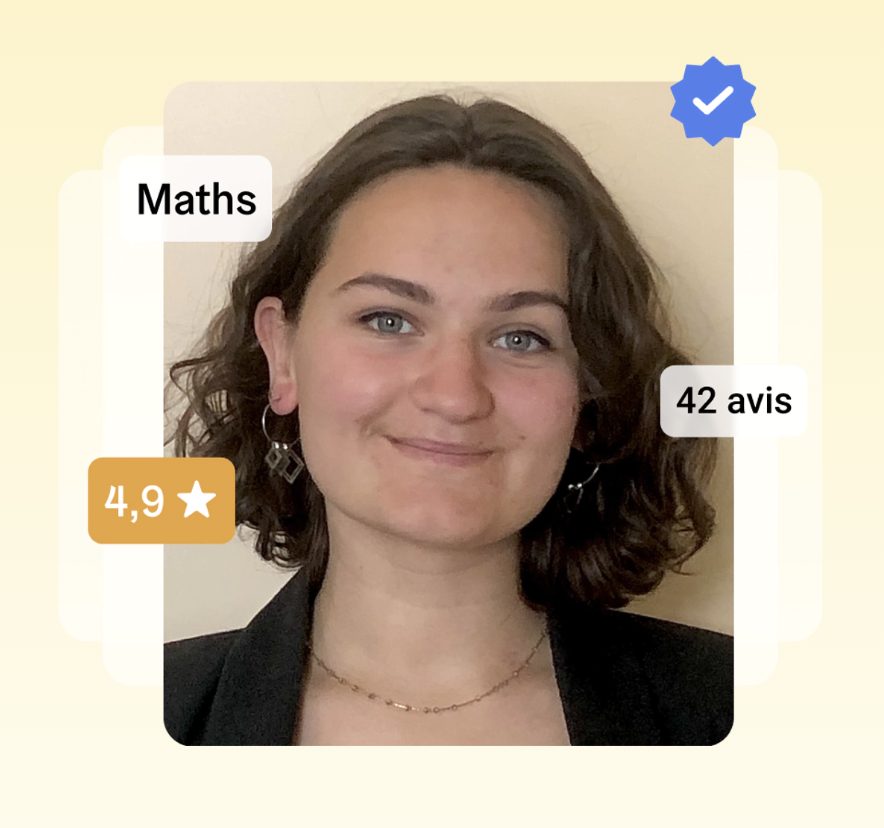On connaît surtout Virgile pour sa célèbre épopée, L’Énéide, mais ce poète a plus d’une corde à son arc. Œuvre lyrique et didactique, Les Géorgiques se présentent comme un véritable traité sur l’agriculture et la beauté. Ce poème, écrit lorsque l’écrivain latin était au sommet de son art, nous réserve d’incroyables surprises qu’ils nous tardent de découvrir avec toi ! 💫
| Fiche d’identité 🔎 | |
|---|---|
| Titre | Les Géorgiques |
| Écrivain | Virgile |
| Date de publication | vers 29 av. J-C |
| Genre | Poésie |
| Registre | Didactique |
Présentation générale de l’œuvre 📖
Pourquoi Virgile a écrit les Géorgiques ? ✍️
Virgile, dit « le Cygne de Mantoue », a publié Les Géorgiques pour rendre hommage à Mécène. Cet homme politique romain et proche de l’empereur Auguste (d’abord appelé Octave) lui a commandé ce poème géant.
👉 Pourquoi lui avoir dédié ces poèmes ?
Pour la simple et bonne raison que Mécène était connu pour consacrer sa fortune et son influence à la promotion des arts et des lettres. Si tu as aujourd’hui la chance d’admirer de beaux tableaux ou de lire des textes sensationnels, c’est un peu grâce à lui 😏
Ce qu’il faut aussi savoir, c’est que Virgile a publié son œuvre à la suite de la victoire du futur empereur Octave. Lorsque Cléopâtre et Antoine se sont retirés à Alexandrie, Octave a apporté la paix au sein de l’État romain qui était déchiré par des guerres civiles.
À lire aussi
🍂 Fan de la nature ? Découvre Chanson d’automne de Verlaine !
Le contenu des quatre parties du livre de Virgile, tourné vers la thématique de la terre, montre qu’il soutenait les efforts d’Octave en faveur de l’agriculture italienne et qu’il encourageait le peuple romain à s’intéresser au métier de paysan 🧑🌾
En cela, Les Géorgiques mettent en lumière un véritable souffle de vie, une morale fondée sur l’effort et le travail de la terre. Virgile veut montrer que, si l’on se donne les moyens, on peut s’élever et réfléchir à la place que l’on a au sein de la nature 🍀
💡 Le savais-tu ?
Après avoir été un pays rural, l’Italie s’est modernisée de manière inégale au XIXᵉ siècle. Résultat ? Le nord aborde des paysages riches et industriels, le sud paraît pauvre et rustique.
Résumé général des Géorgiques de Virgile 💫
Les Géorgiques sont composés de 2 188 vers en hexamètre dactylique et tiennent leur nom du mot grec « geōrgikós » :
- gê signifie « terre »
- érgon signifie « œuvre » ou « travail »
👉 L’œuvre de Virgile fait l’éloge de la campagne italienne et de l’agriculture. Dans Les Géorgiques, l’écrivain parle même des « devoirs religieux de la vie rurale ». Cette phrase montre que l’écrivain latin ne s’arrête pas à de simples conseils sur la façon de cultiver mais apporte une dimension philosophique et religieuse à ses quatre livres (ou « chants »).

👉 Comment sont constitués Les Géorgiques de Virgile ?
Tout vient du traité en langue punique du Carthaginois Magon. En vingt-huit livres, cet érudit a répertorié toutes les informations qu’on avait sur l’agriculture.
💡 Le savais-tu ?
De agri cultura (160 av. J-C) est un traité de Caton l’Ancien. Ce livre était considéré comme LE manuel du fermier accompli.
👉 L’auteur y parle des règles d’élevage et de gestion des fermes à suivre en dévoilant quelques anecdotes croustillantes sur la vie rurale des paysans de l’époque.
Pendant plusieurs siècles, son livre est resté l’une des seules sources connues sur ce sujet. Enfin… jusqu’à l’arrivée de Varron ! Cet écrivain romain a résumé l’ouvrage de Magon en trois livres en mettant en avant : l’agriculture, le bétail, les volailles, le gibier et les viviers.
✍️ Virgile a repris ces éléments en apportant des modifications :
- il développe l’agriculture en deux volumes
- il n’évoque pas les volailles, le gibier et les viviers
- les abeilles apparaissent dans le dernier texte
L’œuvre est divisée en quatre livres qui suivent la même progression. Virgile évoque d’abord ce qui est matériel avant de parler de ses méditations.
📘 Quels sont les quatre livres ?
🌽 Le travail de la terre avec la culture du blé et les conditions favorables pour une bonne production.
↪️ Exemple
Si ton terrain est gras, dès la saison nouvelle
Qu’on y plonge le soc, et que l’été poudreux
Mûrisse les sillons embrasés par ses feux.
🍇 La vie végétale avec les soins qu’il faut apporter à la vigne.
↪️ Exemple
De rameaux étrangers un arbre s’embellit,
D’un fruit qu’il ignorait son tronc s’enorgueillit ;
Le poirier sur son front voit des pommes éclore,
Et sur le cornouiller la prune se colore.
🐮 La vie animale et l’élevage avec des méditations sur l’amour, les épidémies et les maladies mortelles.
↪️ Exemple
L’horrible sanglier se prépare à la guerre ;
Il aiguise sa dent, il tourmente la terre :
Contre un chêne ridé s’endurcit aux assauts,
Hérisse tous ses crins, et fond sur ses rivaux.
🐝 Les abeilles, l’exemple parfait pour bâtir une communauté humaine idéale.
↪️ Exemple
Mécène, daigne encor sourire à mes abeilles.
Dans ces petits objets que de grandes merveilles !


Besoin d’un prof particulier de français ? ✨
Nos Sherpas sont là pour t’aider à progresser et prendre confiance en toi !
Les Géorgiques de Virgile : résumé détaillé 📜
Livre I : 514 vers pour avoir les pieds sur terre 🌽
👉 D’emblée, l’écrivain annonce le sujet de chaque chant :
- La terre : Je chante les moissons : je dirai sous quel signe
- Le végétal : Il faut ouvrir la terre et marier la vigne ;
- Le bétail : Les soins industrieux que l’on doit aux troupeaux ;
- Les abeilles : Et l’abeille économe, et ses sages travaux.
Il évoque ensuite plusieurs divinités agricoles comme Pan, le dieu des bergers et des troupeaux, avant de parler du fameux Octave qu’il compare à César.
🖐️ Dans ce premier livre, cinq thèmes sont mis en avant :
- Vers 54-63 : la spécificité des régions d’Italie, d’Orient et de Grèce
Virgile décrit par exemple l’Euxin (ancien nom de la mer Noire) et le Tmole, une montagne située en Turquie.
Le Tmole est parfumé d’un safran précieux.
Virgile
Poète
- Vers 63-159 : la nature des sols
L’écrivain utilise des termes propres au monde de la campagne comme « moissonné », « sème », « engrais», « laboureur», « sillons», « champs», « fertilité», etc. …
Il explique également que la terre est une mère nourricière (oh la belle personnification 😏) et qu’un paysan doit prier les divinités pour que le temps lui soit favorable.
Même si le travail de la terre est pénible, il ne doit pas le considérer comme une punition. Le dur labeur serait en fait une vertu de Jupiter qui nous amènerait à être constant dans nos efforts.
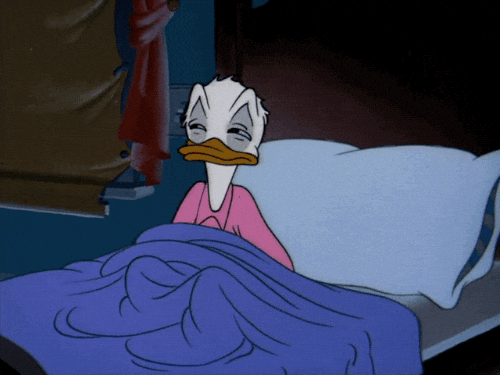
Le travail de la terre empêcherait aussi d’être dominé par Saturne, le dieu romain en charge de la période qui précède le solstice d’hiver. Lorsqu’un paysan maîtrise la culture (le mot renvoyant ici à l’agriculture ET à la civilisation), il contrôlerait en fait le monde 🤔
- Vers 160-203 : les modes de culture ancestraux
Virgile cite des techniques (le traçage des sillons dans la terre, l’utilisation d’un attelage de bœufs…) avant de parler d’outils tels que l’araire courbé, les herses et les houes ⛏️
↪️ Exemple
De huit pieds en avant que le timon s’étende ;
Sur deux orbes roulants que ta main le suspende :
Et qu’enfin tout ce bois, éprouvé par les feux,
Se durcisse à loisir sur ton foyer fumeux.
Si on fait honneur à ces apprentissages, on devient maître de la nature et elle nous apportera la « gloire d’un divin domaine ».
- Vers 204-350 : le ciel
Pour faire simple, Virgile explique comment le ciel permet des moissons abondantes lorsque les rapports pluie/soleil et ombre/lumière sont optimaux.

- Vers 351-514 : les phénomènes météorologiques
Virgile s’intéresse surtout aux vents en expliquant que certains signes comme le mouvement des oiseaux permettent de prévoir le mauvais et le beau temps.
👉 L’écrivain évoque par ailleurs les divinités :
- Les dieux du Soleil et de la Lune s’expriment sur des événements politiques en provoquant des éclipses, des tempêtes ou autre moment marquant
- Mars se déchaîne sur l’univers à cause des sanglantes batailles de Philippes.
À lire aussi
Découvre Les Contemplations de Victor Hugo 🕊
Dans cette partie, on remarque aussi une méditation sur la guerre. Virgile se questionne tristement et veut savoir pourquoi les divinités ont permis ces conflits fratricides qui ont attiré le courroux de Mars.
Livre II : 542 vers à lire dans un espace vert 🌳
Le deuxième ouvrage fait honneur aux arbres, les petits protégés du dieu de la croissance et de la fécondité Bacchus. Virgile parle de leur mode de reproduction naturel et détaille des notions : le bouturage et le greffage.
🪴 Le bouturage est un mode de multiplication végétative de certaines plantes. En gros, il permet de donner naissance à un végétal à partir d’un autre végétal. Imagine-toi qu’on prélève une partie d’une plante (une branche feuillue) et qu’on l’utilise pour obtenir une nouvelle plante.
🌿 Le greffage permet aussi de reproduire une plante mais on l’utilise sur des plantes fragiles dont le semis ne donne pas de résultats concluants.
👉 Pour Virgile, ces deux techniques sont représentatives d’une collaboration réussie entre la Nature et l’être humain.
💡 Relevons d’ailleurs que la vigne est l’un de ses exemples favoris ! Virgile énumère beaucoup de noms d’arbres et d’arbustes dans son livre (le hêtre, l’olivier, le saule, le poirier, etc.) mais donne une place privilégiée à la vigne. 🍇
↪️ Exemple
Notre vigne fleurit suspendue aux ormeaux ;
La grappe de Lesbos rampe sur les coteaux ;
Les raisins sont tardifs, ou se pressent d’éclore ;
Le pourpre les rougit, ou le safran les dore :

Ce qu’il faut noter, c’est que cette partie paraît moins structurée que les autres puisqu’elle prend la forme d’une énumération lyrique. Le poète écrit de véritables hymnes à la joie en faisant l’éloge de l’Italie, du printemps, du réveil de la nature et des vertus de la vie paysanne.
Livre III : 566 vers qui rendent chèvre 🐐
Ce qu’on remarque dès le début, c’est que ce livre est introduit par un prologue de 51 vers. Virgile commence par évoquer Palès, la déesse romaine des bergers, le « berger des bords de l’Amphryse », Mécène et César.
😯 Encore plus surprenant : Virgile révèle le grand thème de cette partie (l’élevage) sans jamais parler de ses aspects économiques et des animaux domestiques comme les poules et les cochons.
À lire aussi
Découvre Les Vrilles de la Vigne de Colette ! 🕊
La première partie du livre fait référence au bœuf et au cheval et met l’accent sur le développement de ces espèces, les soins qu’il faut leur donner et la patience qu’un paysan doit avoir pour dresser les jeunes animaux. Virgile admire la beauté des chevaux qui sont élevés pour la course (la gloire) ou la guerre (l’honneur) 🐴

Au-delà de ça, on voit que l’écrivain souhaite faire plus que simplement parler d’élevage et de dressage. Il s’intéresse aux liens entre les hommes et les bêtes. Selon lui, une forme de fraternité existe entre ces êtres vivants qui sont tous deux capables de communiquer, aimer, souffrir et mourir.
L’amour est le même pour tous.
Virgile
Poète
La deuxième partie est consacrée au petit bétail. Virgile explique qu’il faut prendre garde aux brebis afin de profiter de leur laine et de leur lait. Enfin… comme pour les chevaux, notre ami à un petit faible pour un type d’animal : les chèvres sauvages (tu sais, celles qui défient la gravité !) 😱
Amoureux de ces animaux indépendants, Virgile évoque les maladies et les prédateurs qui les mettent en danger. Il propose une description (quasi) apocalyptique de la peste qui a ravagé les troupeaux du Norique, un royaume celtique constitué au IIe siècle av. J-C.
Livre IV : 566 vers vraiment bzzzz 🐝
Virgile accorde beaucoup d’importance au travail des abeilles dans leur milieu de vie et explique comment est constituée une ruche et comment fonctionne un essaim.
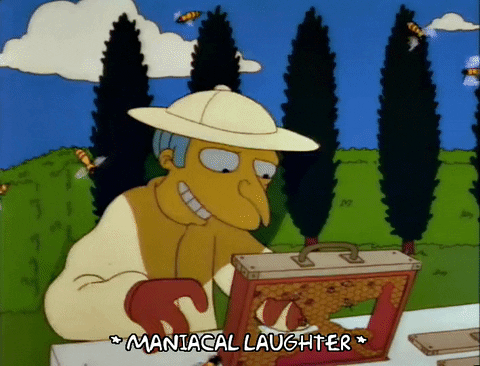
Lorsqu’il parle de ce thème, il le relie à l’horticulture, l’art de cultiver les jardins et de conserver les plantes. S’il entremêle ces sujets, c’est parce qu’il veut représenter la société idéale 🌞
On apprend que Virgile préfère le « jardin des abeilles » à un domaine de plusieurs hectares. Pour lui, une exploitation à taille humaine est ce qui permet de trouver le bonheur. Ce n’est qu’en travaillant à petite échelle qu’on peut être proche de la nature et vivre de façon sereine et équilibrée.
À lire aussi
Découvre Juste la fin du Monde résumé ! 📚
🧑🌾 Virgile va même plus loin en utilisant la vie des abeilles comme une métaphore de la vie humaine parfaite. Il fait le parallèle entre le quotidien dans la ruche et dans une cité, parle de labeur collectif et montre que les abeilles sont dévouées à leur roi comme on l’est à notre patrie.
C’est d’autant plus incroyabzzz (d’accord, on arrête) lorsque l’on sait que Virgile adore méditer sur un procédé utilisé en Égypte pour ressusciter les abeilles : la bougonie 🍯 Cette méthode viendrait de l’histoire du berger Aristée. Il aurait pleuré la mort de ses abeilles et aurait appris par Protée, le dieu des métamorphoses, qu’une raison se cachait derrière ce drame.
Selon la divinité, la destruction de l’essaim serait le châtiment suscité par Orphée pour la mort d’Eurydice. Cyrène, nymphe et mère d’Aristée, aurait transmis à son fils les rituels à respecter pour obtenir le pardon des nymphes des bois (les compagnes d’Eurydice) et des mânes d’Orphée.

La légende raconte qu’une fois ces rituels accomplis, une nuée d’abeilles se serait échappée des cadavres de bovins en décomposition. C’est sur cette lueur d’espoir (peu ragoutante, certes…) que Virgile choisit de nous quitter.
👉 Il conclut Les Géorgiques par le vers « Célébrais les amours et les jeux des bergers » qui est à la fois optimiste et représentatif de la vitalité qu’exprime son œuvre lyrique et didactique.
Les caractéristiques de la poésie didactique 📕
La poésie didactique est un genre littéraire hérité de l’Antiquité gréco-latine qui a pour but de transmettre un savoir sur un domaine précis comme la chasse, l’astronomie ou encore l’amour. Comme ses prédécesseurs, Virgile a été influencé par des auteurs grecs et a contribué à perpétuer cette tradition en latin.
À lire aussi
Plonge dans l’univers des Contes de Hans Christian Andersen ! 📚
👉 Grâce à la théorie de Katharina Volk, The Poetics of Latin Didactic, on peut définir ce genre selon quatre critères :
1. L’intention didactique explicite
Dès le début du poème, Virgile dévoile sa volonté didactique en explicitant l’aspect pratique de son texte (transmettre un savoir) et les thèmes qui le composent.
Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est que l’écrivain ne se contente pas de rédiger un traité mais montre qu’il est avant tout un poète. Son activité première est de chanter : « Voilà ce que maintenant je vais chanter. »

Virgile insiste encore plus sur la valeur didactique de son œuvre au deuxième livre des Géorgiques. Le poète fait de nombreuses références qui montrent ses connaissances :
- Les Travaux et les Jours de l’écrivain grec Hésiode : « Je chante le poème d’Ascra par les villes romaines ». Ascra renvoie à la cité qui a inspiré le poète.
- Les textes de Nicandre, Aratus et Lucrèce qui lui ont donné le bagage scientifique nécessaire pour écrire Les Géorgiques.
2. La relation maître/élève
Dans la poésie didactique, on retrouve souvent la relation maître/élève puisqu’elle montre que l’écrivain cherche à transmettre. Dans Les Géorgiques, on distingue deux élèves différents : l’agriculteur et Mécène.
- Mécène est mentionné au début du texte.
- Virgile s’adresse au paysan au futur et à l’impératif : « tu laisseras les champs se reposer une année » (v. 71), « Implorez des hivers sereins, paysans ! » (v. 100).
💡 À noter
Il semble que Virgile ne dissocie pas négativement d’un côté les pauvres paysans et de l’autre l’empereur mais s’adresse plutôt au genre humain.
Il cherche à mettre en lumière deux pratiques qui seraient la transmission du savoir agricole dans le cadre d’un « retour à la terre » et le chant poétique pour célébrer la grandeur retrouvée de Rome à nouveau en paix.
3. L’intention poétique explicite
Au début et à la fin de son ouvrage, Virgile parle de chant pour qualifier Les Géorgiques : « je vais dès maintenant chanter » et « je chantais ». Le poète situe son intention poétique entre les pôles de la terre (le rivage) et de la mer (le large).
- La terre symbolise la vie agricole et l’Italie
- Le large évoque les récits d’Homère comme l’épopée d’Ulysse
👉 En soi, Les Géorgiques sont le mélange parfait et équilibré d’un texte didactique et d’un élan poétique.
4. L’effet de simultanéité poétique
La simultanéité poétique désigne une pratique basée sur l’émission simultanée de plusieurs voix indépendantes (c’est ce qu’on appelle la « polyphonique »).
En représentant une relation maître/élève et en s’évoquant lui-même dans son œuvre, Virgile tente de produire un effet de simultanéité. Pour ce faire, il utilise par exemple la première personne du singulier ou interpelle directement Mécène.


Ton premier cours particulier de français est offert ! 🎁
Tous nos profs sont passés par les meilleures écoles de France !
Qui est Virgile ? ✒️
Publius Virgilius Maro, ou Virgile pour les intimes, est un poète latin né le 15 octobre 70 av. J-C et mort le 21 septembre 19 av. J-C.
Il a grandi à la campagne (on sait d’où lui vient son goût pour la ferme) et a découvert la littérature grecque et latine trois ans avant d’adopter une toge virile. Non non, ça ne veut pas dire que cette toge est faite pour les grands costauds avec de la barbe… C’est juste le vêtement officiel du citoyen romain adulte.
🏆 Côté littérature, beau palmarès ! Trois de ses œuvres ont marqué le monde : L’Énéide, Les Bucoliques et Les Géorgiques. On dit même que ce dernier poème a été lu par Virgile devant Octave, l’empereur amateur de poésie. Renoncer à ses études en politique pour se consacrer à la poésie n’était peut-être pas une si mauvaise idée…
[Le] plus grand génie que la terre ait porté.
Paul Claudel
Dramaturge
💖 Quelle est sa personnalité ?
Virgile était un fou de la perfection ! Après avoir consacré les dix dernières années de sa vie à la rédaction de l’Enéide, il meurt au port italien de Brindes à cause d’une insolation. Accroche-toi bien… Sa dernière volonté était de brûler son livre parce qu’il comportait encore des imperfections qu’il n’avait pas corrigées !
Auguste n’a pas accepté cette requête et a fait publier le poème qui connaîtra un succès fulgurant. Tout est bien qui finit bien… On suppose ?
Alors, que penses-tu des Géorgiques ? ❤️
En voulant inciter les hommes à cultiver la terre plutôt que leurs conflits, Virgile a donné naissance à un magnifique ouvrage didactique et poétique. Si Les Géorgiques célèbrent donc une vie de dur labeur, les lecteurs, eux, célèbrent Virgile et ses écrits qui donnent la larme à l’œil 😭
FAQ ✅
Pourquoi Virgile à écrit les Géorgiques ?
Virgile a écrit les Géorgiques pour plusieurs raisons. Cet ouvrage a été commandé par Mécène, le mécène de Virgile, qui cherchait à promouvoir les valeurs romaines traditionnelles à une époque de changement et de conflit. En effet, les Géorgiques ont été écrites pendant la période de la guerre civile romaine. Virgile s’est servi de ce poème pour montrer les bienfaits de la paix et de la stabilité, et pour encourager le retour à l’agriculture, ce qui était en accord avec les idéaux d’Auguste, le premier empereur romain. De plus, Virgile admirait la nature et la campagne, et il a voulu partager cette admiration à travers son poème.
Quels sont les styles définis par Virgile ?
Virgile est connu pour son style poétique lyrique et son utilisation sophistiquée de la langue latine. Dans les Géorgiques, il emploie un style didactique pour enseigner à ses lecteurs sur l’agriculture et la nature. En même temps, il utilise la métaphore et l’allégorie pour transmettre des messages plus profonds sur la vie, la société et la politique. Son style est caractérisé par une grande précision dans la description des détails, une grande musicalité et un rythme cadencé.
Qui est Mecene dans les Géorgiques ?
Dans les Géorgiques, Mécène est à la fois un personnage et une figure historique. En tant que personnage, il est le destinataire du poème de Virgile, le mécène qui a commandé l’œuvre. En tant que figure historique, Mécène était un homme politique et un conseiller d’Auguste, le premier empereur romain. Il était également un mécène des arts et des lettres, et il a soutenu de nombreux artistes et écrivains, y compris Virgile.