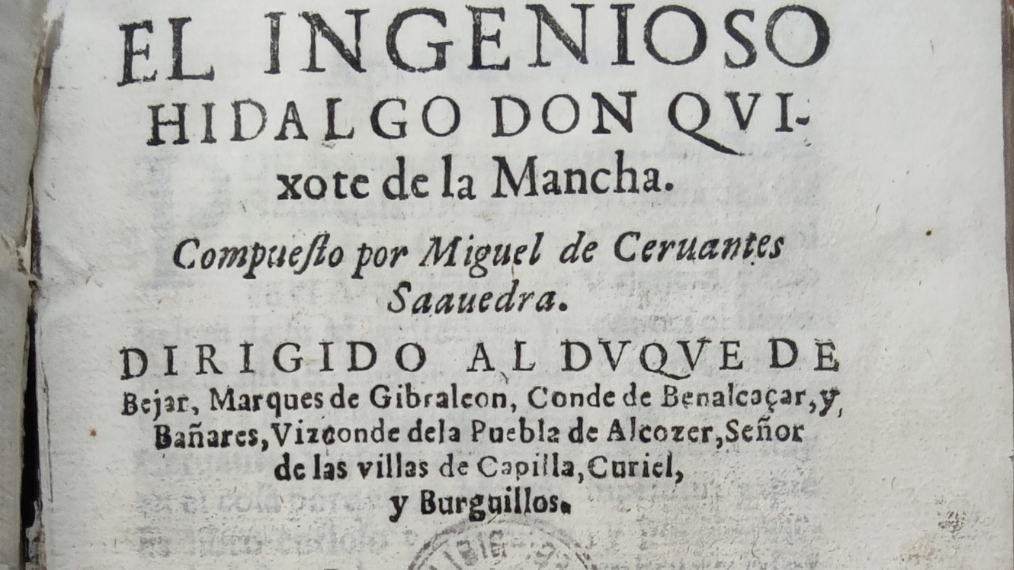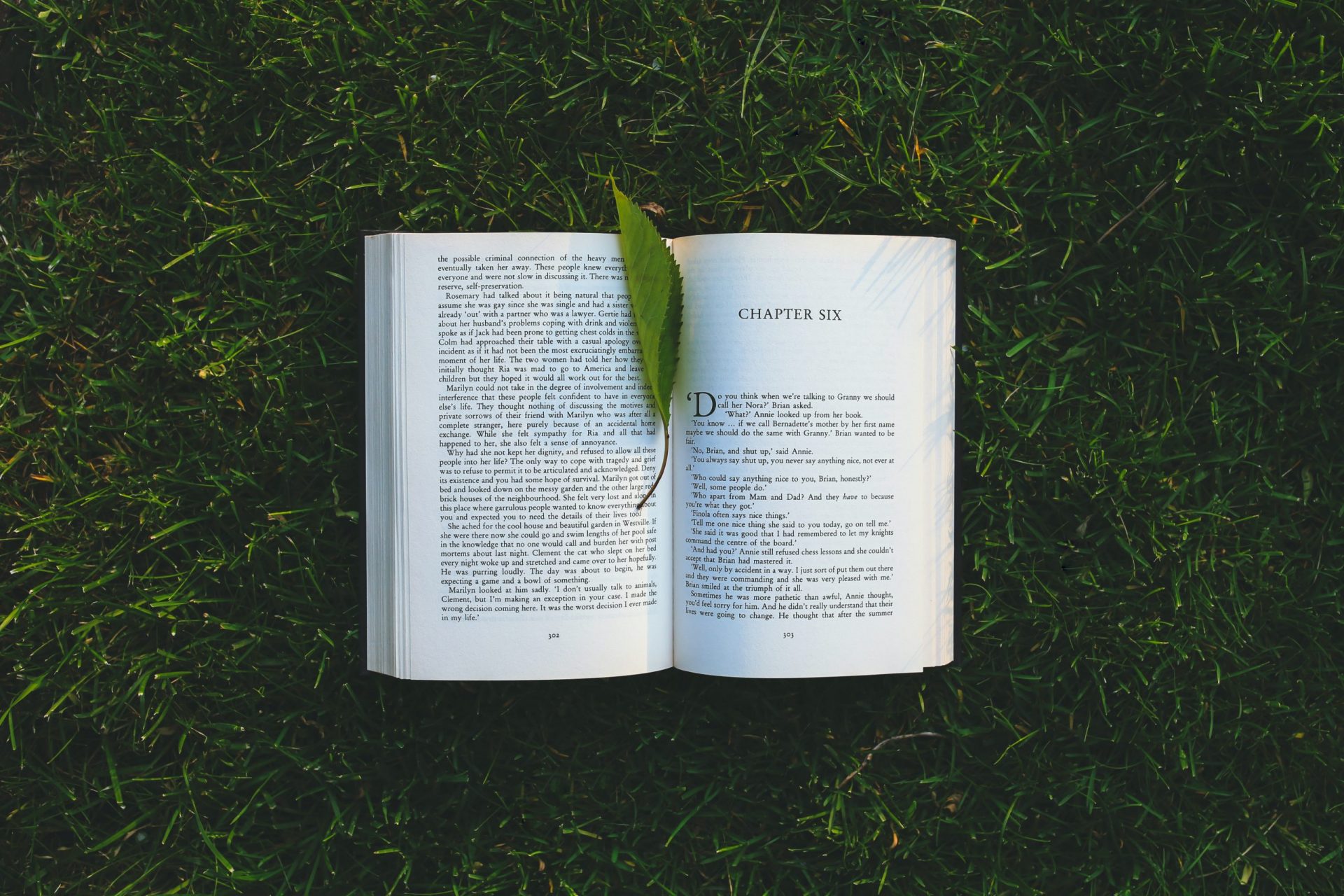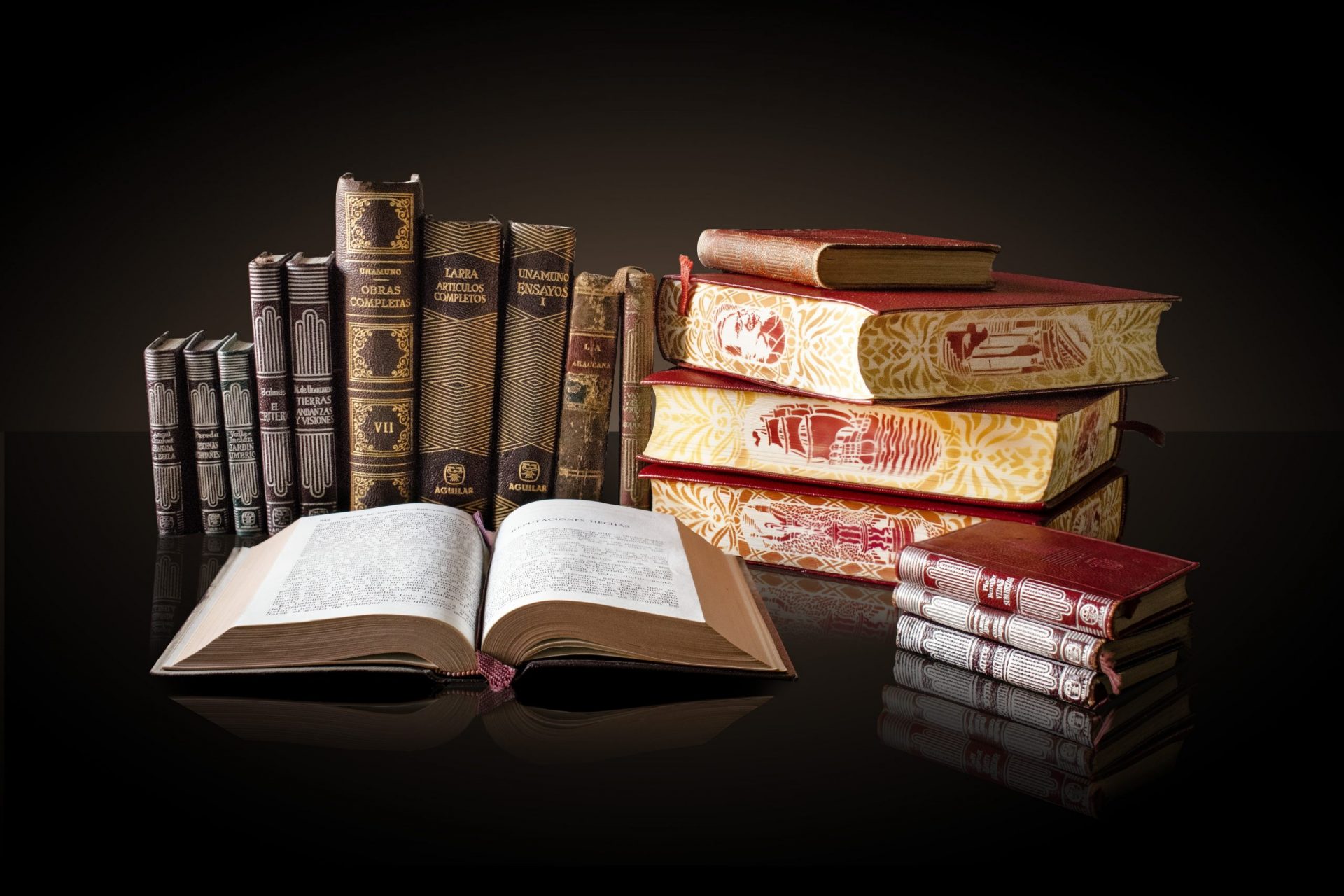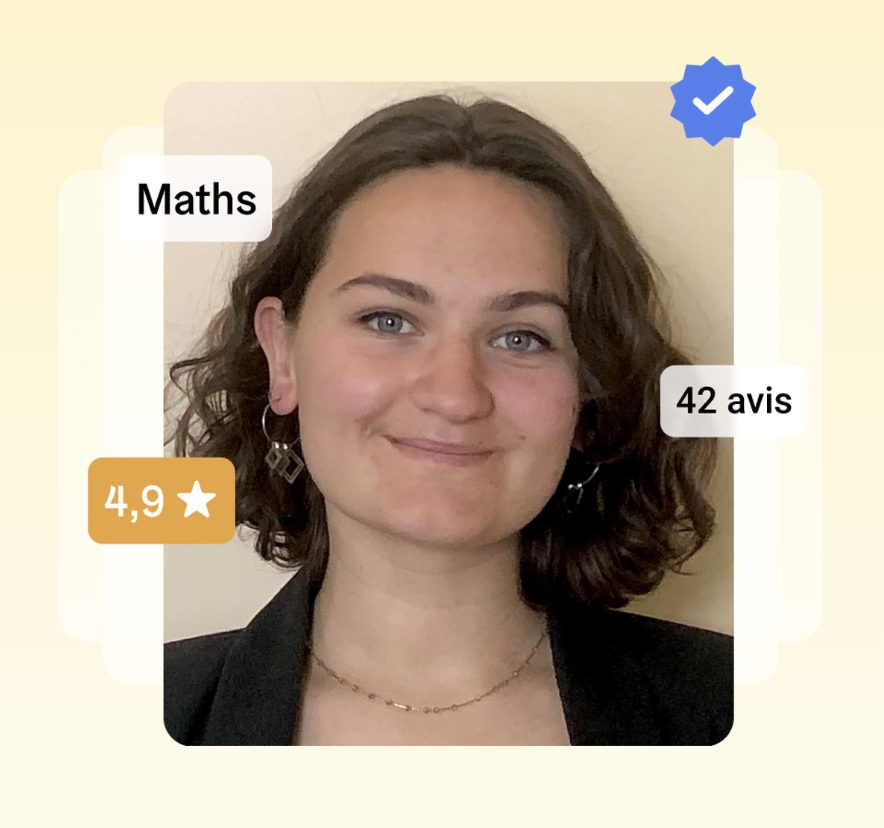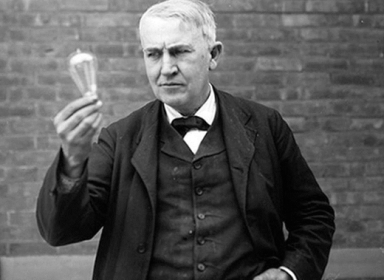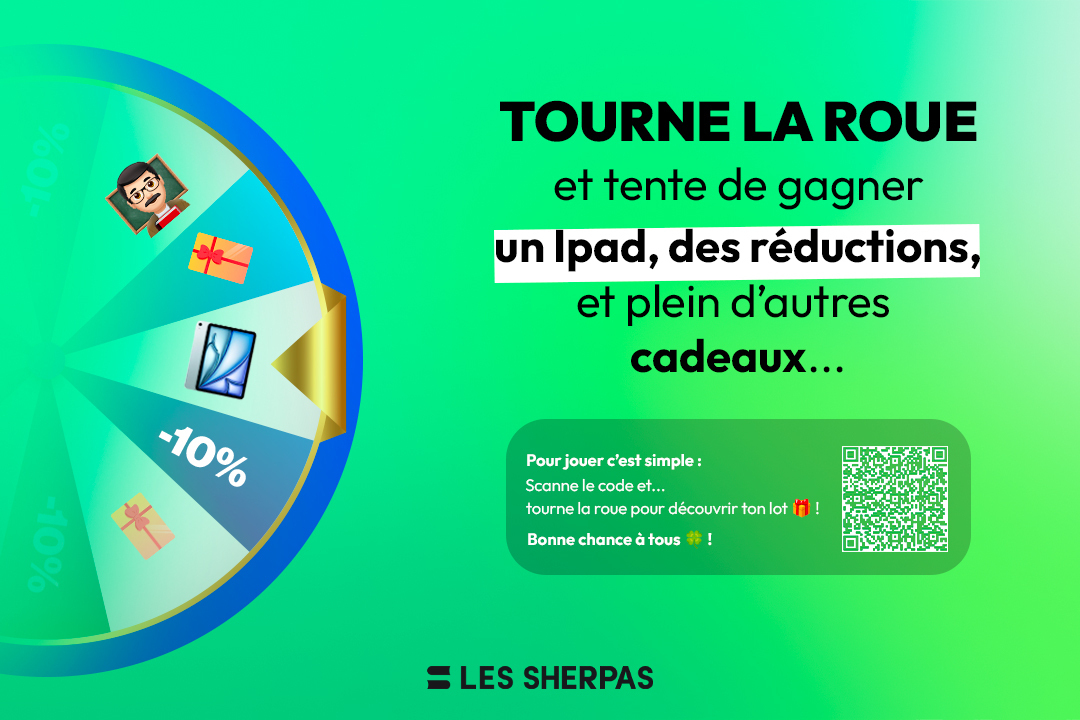Sir Thomas More, aussi connu sous le nom de saint Thomas More est décrit comme la voix de la conscience lors de la première Réforme anglaise et l’une des plus grandes figures du XVIe siècle. Il est à la fois savant, juriste, théologien et homme d’État. Tu connais peut-être son œuvre L’Utopie qui a marqué la naissance d’un nouveau genre littéraire, celle de la vision d’une société parfaite. Prêt à découvrir la biographie de ce personnage emblématique ? Let’s go! 🚀
| Fiche d'identité | |
|---|---|
| Nom | Thomas More |
| Naissance | 7 février 1478 à Londres |
| Décès | 6 juillet 1535 à Tower Hill |
| Activité | Philosophe, homme d'État, romancier, juge, diplomate, poète, théologien, homme politique, historien, écrivain |
| Œuvre principale | L’Utopie (1516) |
Famille et premiers pas 👪
Fils de John More, un homme de loi, Sir Thomas More devient page du cardinal Morton, archevêque de Cantorbéry, entre 1490 et 1492. Grâce à Morton, il entre à l’université d’Oxford, puis en 1494, il poursuit ses études de droit à New Inn et à Lincoln’s Inn, où il a comme maître Érasme. Il devient avocat à 21 ans et défend les marchands de la City. Il enseigne ensuite le droit jusqu’en 1510 et devient juge, élu par les Londoniens. 🏛️
👰 En 1505, il épouse Jane Colt, avec qui il a trois filles et un fils. Malheureusement, Jane décède en 1511. Il se remarie avec Alice Middleton, une veuve avec deux enfants.
💡 Pour info
Érasme, ça te dit quelque chose ? Oui, c’est bien Erasmus comme le programme d’échange ! Érasme est un philosophe hollandais qui a beaucoup contribué au développement de l’humanisme, un mouvement intellectuel qui valorise la connaissance, la culture et la dignité humaine.
Contexte historique 💫
On peut dire que la période entre 1400 et 1600 est celle où tout a changé en Angleterre (et même en Europe). Tu l’as bien deviné, il s’agit de l’époque de la Renaissance durant laquelle on passait du Moyen Âge aux Temps modernes. Pendant cette période, les gens ont renouvelé leur vision de l’humanité et ont commencé à remettre en question l’importance de Dieu.
Pourquoi dit-on « Renaissance » ? 🤔 Il y a eu un renouveau dans les domaines scientifiques et artistiques inspiré par l’Antiquité, faisant renaître les œuvres de celle-ci, d’où le terme « Renaissance ».
👑 Pour rappel
Quand Thomas More entame une carrière politique, les rois d’Angleterre étaient Henri VII (1504-1509) et Henri VIII (1509-1547). Ce dernier est célèbre pour avoir initié la Réforme anglaise en rompant avec l’Église catholique romaine. C’est comme ça qu’il établit l’Église anglicane et sa propre autorité religieuse en Angleterre.
Ton premier cours particulier est offert ! 🎁
Nos profs sont passés par les meilleures écoles et universités.
Une carrière avec beaucoup de drama 😬
C’est dans ce contexte que la carrière de More se construit. Dès 1504, il rejoint le Parlement en s’élevant contre les taxes demandées par le roi Henri VII pour une guerre en Écosse. Les ennuis commencent quand le roi enferme son père. Thomas prend une pause en France en 1508, mais revient avec l’arrivée d’Henri VIII en 1509, mais ça se ne passe comme prévu ! 😬
↪️ D’abord, il gère les affaires du cardinal Thomas Wolsey, puis devient maître des requêtes et rejoint le Conseil privé du Roi. Il se lance dans des missions à l’étranger, comme les Pays-Bas en 1515 (c’est là qu’il écrit Utopie dont on te parlera plus tard), puis à Calais en 1517. En 1521, il devient trésorier de la Couronne et en 1523, il se retrouve Président de la Chambre des Communes.
Réforme de la religion ⛪
Dans les premières années du XVIe siècle, l’humanisme arrive en Angleterre et Érasme (1466-1536) enseignait depuis deux ans à l’Université de Cambridge, formant toute une génération de théologiens. C’est à Cambridge, en 1520, qu’un petit groupe d’académiciens a été touché par les idées de Martin Luther, un moine et théologien qui a provoqué la réforme protestante en Europe occidentale.
✝️ Protestantisme vs Catholicisme
Au XVIe siècle, Martin Luther et Jean Calvin veulent réformer l’Église. Ils étudient, traduisent et enseignent la Bible en langage courant et propagent leurs idées religieuses. Leurs enseignements déclenchent des conflits qui, au siècle suivant, contribuent à remodeler l’Europe.
Bien qu’ils aient des points communs, le catholicisme et le protestantisme ont également pas mal de différences. En voici quelques-unes des plus importantes :
Catholiques :
✔️ Reconnaissent l’autorité du pape.
✔️ Lisent la Bible mais sont aussi attachés à la tradition.
✔️ Prient les saints pour intercéder.
Protestants :
✔️ Rejettent l’autorité du pape.
✔️ Mettent l’accent sur la lecture personnelle de la Bible.
✔️ Ne prient pas les saints, privilégient la prière directe à Dieu.
Le divorce d’Henri VIII 🫅
Henri VIII monte sur le trône en 1509. En 1504, il épouse Catherine d’Aragon (née en 1485), la veuve de son frère aîné. Catherine donne naissance à plusieurs enfants, dont seule Mary, née en 1527, survit. Le roi, âgé de 36 ans en 1527, n’a pas d’héritier mâle. Obsédé par la nécessité d’avoir un fils pour assurer la stabilité du trône, il décide de demander le divorce de sa femme pour épouser Anne Boleyn, une jeune demoiselle dont il est amoureux.
🤷 Comme tu peux l’imaginer, cela a généré tout un débat : le pape est-il compétent pour donner une dispense ou non ? Les rois anglais au Moyen Âge avaient déjà restreint les droits du pape sur l’Église de leur pays et affirmé que les tribunaux royaux avaient la priorité sur les tribunaux pontificaux (celles du pape). Mais seul le pape Clément VII pouvait annuler le premier mariage d’Henri VIII.

Trop d’infos pour toi ? Pas de panique, un prof particulier d’histoire pourra tout t’expliquer ! 🧑⚕️
La rupture avec Rome 💔
Jusqu’en 1527, les relations entre Rome et Londres étaient assez bonnes, mais la demande d’annulation du mariage du roi posait problème au pape. La demande s’éternise pendant deux ans et le roi s’impatiente. Ne pouvant pas annuler son mariage par Rome, il fait prononcer le divorce par un tribunal anglais en mai 1533. Clément VII réagit en excommuniant Henri en mars 1534. Des représentants du clergé valident le nouveau mariage du roi sous la contrainte.
👑 En novembre 1534, l’« Acte de Suprématie » voté par le Parlement accorde au roi et à ses successeurs le titre de « Chef suprême de l’Église d’Angleterre ». Ça veut dire que tout le pouvoir ecclésiastique (religieux) repose entre ses mains. Le statut du pape est devenu le même que celui de l’archevêque de Rome, sans autorité spécifique en Angleterre. Les archevêques et les abbés ne sont plus consacrés par le pape, mais nommés par le roi, qui est également le seul à pouvoir prendre des mesures disciplinaires.
Le roi fait adopter une loi qui conduit à la dissolution des monastères entre 1536 et 1540. L’Église, qui possédait un tiers des terres en Angleterre, en perd la moitié au profit de la Couronne. Moines et nonnes quittent leurs monastères. Ce bouleversement est accepté par le clergé et le Parlement, sauf par Thomas More.

🔔 Remarque
C’est vrai qu’avec les idées de Luther, on croirait que l’Angleterre devenait protestante, mais en 1539, la loi des Six Articles qui a établi la suprématie de la religion anglicane en Angleterre, a mis fin aux espoirs des Réformateurs. À la mort d’Henri VIII, l’Église d’Angleterre n’était pas une Église protestante, mais une Église catholique sans pape.
Jugement et décapitation ⚰
En 1532, Thomas More se retire de ses responsabilités sous prétexte de douleurs à la poitrine, mais refuse également d’assister au couronnement d’Anne Boleyn. Cette absence est mal perçue et lui vaut des ennuis. Il refuse de reconnaître l’Acte de succession du Parlement et il est emprisonné à la tour de Londres. Jugé coupable de trahison le 1ᵉʳ juillet 1535, il est condamné à être pendu, éviscéré et écartelé. Le roi, avec une certaine clémence, change la peine en décapitation. Ainsi, le 6 juillet 1535, Thomas More subit la décapitation.
👉 Des siècles plus tard, son courage est reconnu. En 1886, il est béatifié par l’Église catholique, puis canonisé en 1935. En 2000, le pape Jean-Paul II en fait le saint patron des gouvernants et des hommes politiques.
Besoin d’un prof particulier ? ✨
Nos profs sont là pour t’aider à progresser !
Contributions majeures 📚
Thomas More est bien l’auteur de L’Utopie, publiée en 1516, l’une des œuvres philosophiques les plus controversées du XVIe siècle. Dans son livre, More cherche à critiquer son époque, dénonce les tendances tyranniques des monarques, l’accumulation de richesses chez les plus riches, ainsi que la facilité des États à entrer en guerre. Est-ce que ça a réellement changé depuis ? Il reste à voir ! 🤷
L’Utopie, c’est quoi ? 🔎
Thomas More est celui qui crée le mot « utopie ». Ce terme vient du grec et signifie « lieu qui n’est nulle part ». Le terme est apparu pour la première fois dans le dictionnaire en 1611. Aujourd’hui, l’utopie désigne un genre littéraire qui vise à décrire une société fictive idéale. 🌈
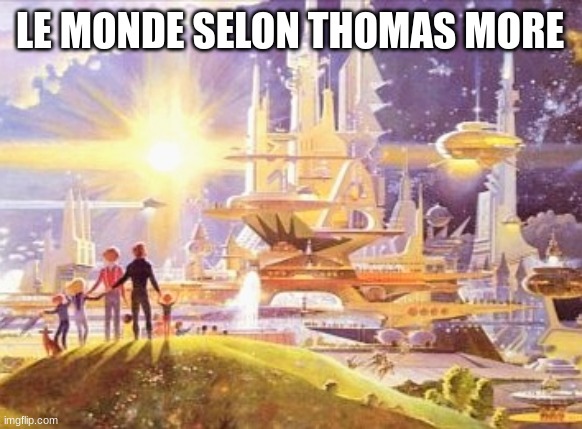
📖 Le livre est divisé en deux parties. La première, sous forme de dialogue entre More et Raphaël Hythloday, un marin portugais, offre une critique de la société anglaise et européenne du début du XVIe siècle. Dans la seconde partie, Hythloday raconte son voyage fictif sur l’île d’Utopie et décrit un État païen idéalisé, fondé sur la raison et la philosophie.
Sur l’île d’Utopie, le bonheur social prime et les institutions sont conçues pour favoriser la stabilité communautaire. 🤩 More propose différentes institutions et encourage la contestation du système actuel. L’Utopie est une sorte d’outil de critique et d’espoir de transformation sociale qui nous invite à réfléchir sur les injustices et les incohérences du monde réel.
⭐ Pour info
More connaissait les travaux d’Aristote et de platon et il est possible de voir le projet de société idéale exploré dans une section de La République, un des dialogues de Platon (coucou Renaissance 👋), comme l’une des influences pour son ouvrage L’Utopie. Eh oui, More n’était pas le premier à parler d’une société idéale, c’est juste le terme « utopie » qui n’existait pas encore.
À lire aussi
Découvre 5 leçons de vie philosophiques 💡
L’héritage de Thomas More ✨
Comme tu peux l’imaginer, un tel homme a laissé derrière lui tout un héritage qui perdure jusqu’à nos jours. Hormis sa pensée et ses idées politiques, on le retrouve aussi dans la culture populaire.
L’institut Thomas More 🏢
En 2004 naît l’Institut Thomas More, un laboratoire d’idées européen et indépendant basé à la fois à Bruxelles et à Paris. Cet institut, aussi connu sous le nom de Think tank, partage les valeurs du libéral conservatisme et se consacre aux enjeux européens et aux relations internationales avec une attention particulière envers la France. 🇫🇷
👉 Cet institut a trois objectifs clés : influencer, échanger et agir. Il mène des programmes de recherche multidisciplinaires qui englobent plusieurs domaines tels que la vie en Europe, les défis internationaux, l’immigration et l’intégration, la société et la culture, l’économie et la compétitivité et d’autres sujets.
Thomas More ou L’homme libre de Jean Anouilh 📕
On retrouve l’héritage de Thomas More aussi à travers l’art et la culture. Thomas More ou L’homme libre, une pièce de théâtre écrite par Jean Anouilh en 1987, met en lumière les derniers moments humoristiques de la vie de Thomas More avant sa décapitation. À l’origine un scénario des années 60, cette pièce évoque un homme qui, malgré sa solitude, conserve une bonne humeur exceptionnelle tout en demeurant fidèle à ses valeurs.
Et voilà, on arrive à la fin de cet article ! On espère que tu l’as trouvé utile, n’hésite pas à nous laisser un commentaire si tu as des questions. 😉