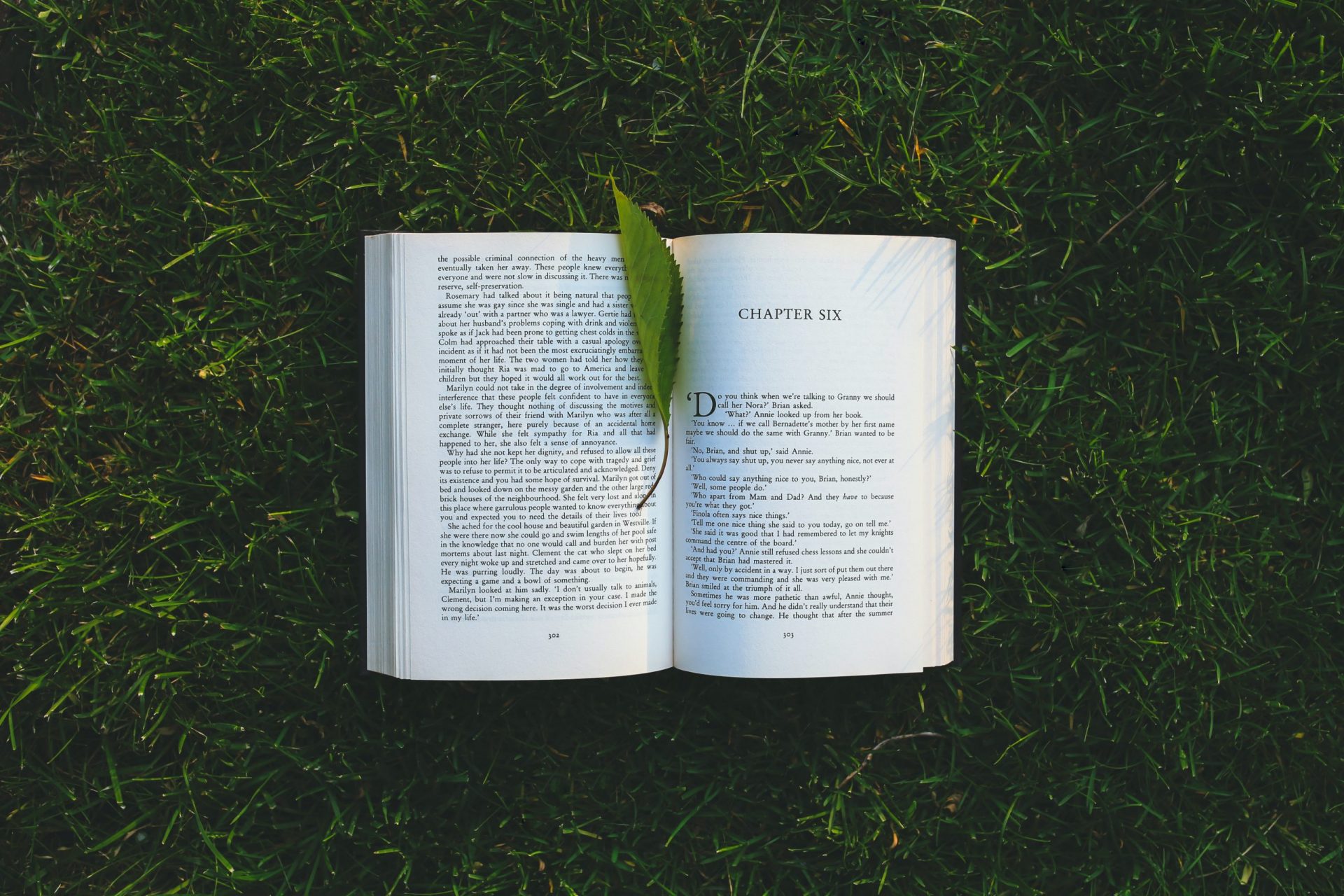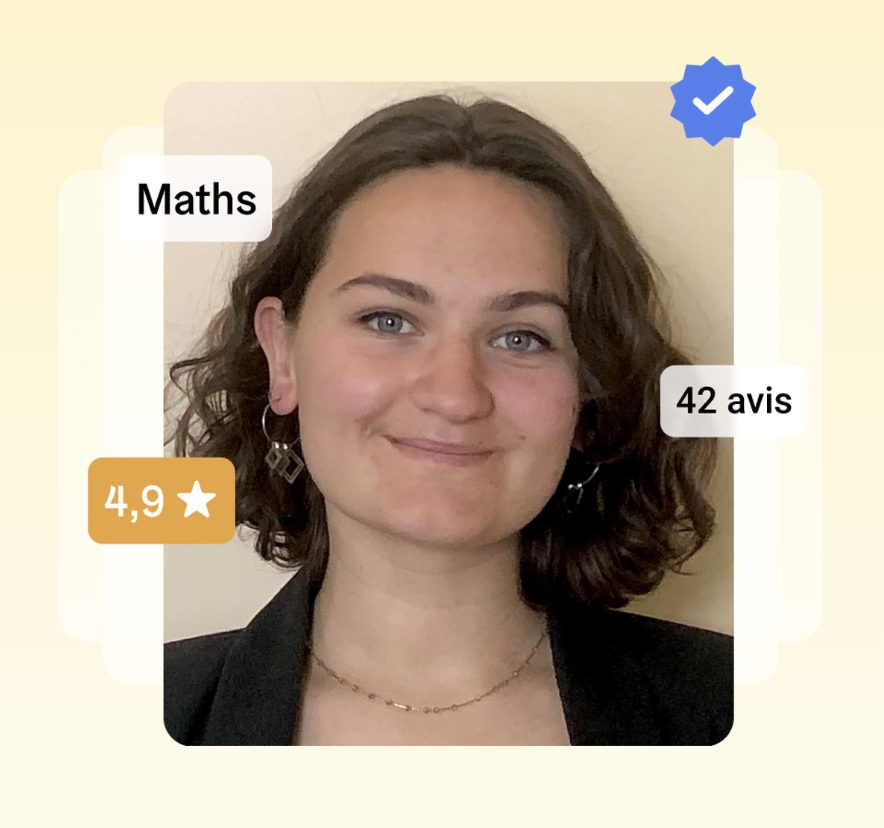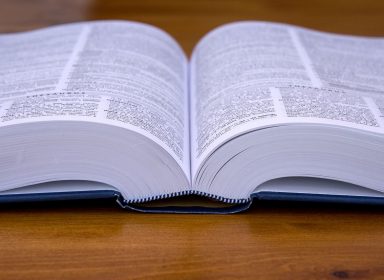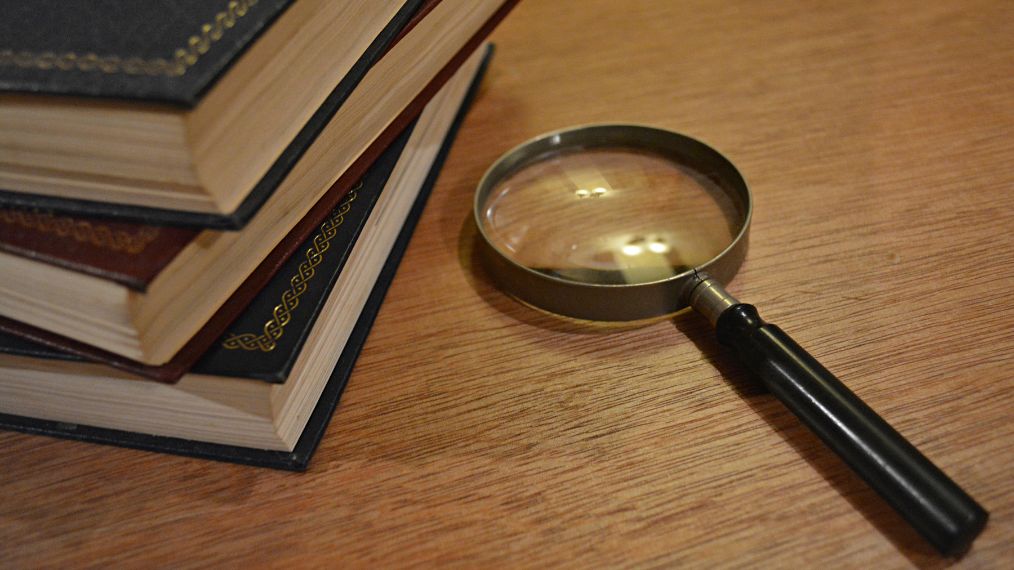Tu n’es pas sans le savoir, la langue française est une langue vivante et elle a la particularité d’évoluer, beaucoup. À l’heure où l’on te parle, de nouveaux mots sont popularisés par la pop culture, les réseaux sociaux, voire même tes discussions avec tes proches. Mais que deviennent ces mots qu’on invente et qu’on utilise dans notre quotidien ? Tes nouvelles expressions deviendront-elles celles de demain ? C’est ce dont on va te parler dans cet article. 🚀
Un néologisme, qu’est-ce que c’est ? 🖊️
Tu as sûrement déjà entendu parler d’un néologisme. Mieux encore, tu en as sûrement déjà utilisé sans savoir que c’en était un. Tu es sûr que ce n’est pas le cas ? Et si on te disait que les mots « courriel », « candidater » ou « lèche-vitrine » en sont… tu reviendrais sur ta réponse ? On t’explique tout.
Pour tes cours de français, connaître cette nouvelle notion te sera très utile, fais-nous confiance. 😉

Définition 🧠
En France, il existe plusieurs définitions à « néologisme ». On appelle ce type de mot a plusieurs sens un mot « polysémique » ou une « polysémie ».
Étymologie 💌
Le mot « néologisme » est issu du grec ancien. Il est une contraction du mot « néos », « νέος », signifiant « nouveau » et du mot « lógos », « λόγος », signifiant « parole ».
Son utilisation la plus courante est celle utilisée en linguistique. Un néologisme, c’est un mot nouvellement créé, mais aussi le fait d’employer un néologisme. Selon Wikitionnaire, c’est un « mot nouveau ou récemment forgé pour répondre à un manque ou pour son caractère expressif ». Selon le dictionnaire Larousse en ligne, c’est « tout mot de création récente ou emprunté depuis peu à une autre langue ».
S’ajoute à cette définition tous les nouveaux sens donnés à des mots ou locutions déjà existants.
Fun Fact ❣️
On appelle « archaïsmes », à l’inverse, les mots qui ne s’utilisent plus et disparaissent de notre vocabulaire.

À lire aussi
Tu veux être incollable sur l’orthographe ? Retrouve tous nos articles sur le sujet.
Ainsi, la « néologie » est la nouvelle discipline linguistique qui analyse les néologismes.
Une langue qui ne connaîtrait aucune forme de néologie serait déjà une langue morte, et l’on ne saurait contester que l’histoire de toutes nos langues n’est, en somme, que l’histoire de leur néologie.
Bernard Quemada
L’un des premiers lexicologues français du XXème siècle (1971)
À savoir 👍
Cette notion peut aussi être utilisée dans un contexte médical. Elle définit les mots inexistants, fabriqués de toute pièce et inventés par des locuteurs souffrant de troubles du langage et/ou psychiques.
On parle alors de néologisme pathologique. Souvent, les personnes concernées n’utilisent ces mots que pour leur usage personnel.
Lorsqu’un langage est composé exclusivement de néologismes, on peut parler de « néolangage ».
Origines 🏛️
« Néologisme » est une dérive du mot « néologie » datant de 1762. Et si ces expressions sont positives aujourd’hui, puisqu’elles représentent l’évolution de notre langue, elles sont toutes deux péjoratives au XVIIIème siècle en France. Elles désignaient ainsi « l’abus de création de nouveaux mots ou de l’emploi de mots anciens avec des nouveaux sens ». Vous avez dit boomer ?
Au début du XIXème siècle, les deux termes sont différenciés d’un point de vue sémantique. Le premier évoque le fait d’utiliser des mots récents sans goût ni besoin tandis que le second représente l’art de trouver des nouvelles façons de définir des actes et objets. Ce, avec des codes bien précis.
Néologie se prend toujours en bonne part, et Néologisme en mauvaise. Tous les mots que j’ai ressuscités appartiennent au génie de la langue française ; ces mots viennent de boutures et sont sortis de la forêt pour former autour d’elle des tiges nouvelles, mais ressemblantes ; ainsi je me fais gloire d’être Néologue et non Néologiste : on a besoin, plus qu’ailleurs, de nuances assez fortes, si l’on ne veut pas être injuste.
L. S Mercier
Écrivain, dans « Néologie, ou vocabulaire de mots nouveaux à renouveler » (1801)
Aujourd’hui, les linguistes utilisent particulièrement ces deux termes, et les élargissent même avec des nouvelles sous-définitions et sous-catégories, qu’on voit avec toi juste après. Les dictionnaires et l’Académie française sont donc obligés de se mettre à la page !

Ton premier cours particulier est offert ! 🎁
Nos profs sont passés par les meilleures écoles et universités.
Identifier ces nouveaux mots dans un texte 🤚
Il n’y a pas réellement de façon d’identifier l’un de ces néologismes dans un texte. Ce n’est pas aussi simple qu’une figure de style qui est, par essence, reconnaissable. Ici, il suffit de connaître les différents types de néologisme et, surtout, une liste lexicale définie.
À lire aussi
Parce qu’il est toujours bon de se faire une piqûre de rappel… Découvre comment identifier toutes les figures de style dans notre dossier dédié.
Types de néologismes ✨
Il en existe deux principaux types :
👉 la néologie formelle : création totale d’un nouveau mot,
👉 la néologie sémantique : réutilisation d’un ancien mot, avec un nouveau sens. Ces nouveaux mots peuvent être originaires du français comme d’une langue étrangère (deux exemples : « industrie » ne prend ce sens qu’après la révolution industrielle et, par anglicisme et traduction, le mot « considérer » se rapproche du verbe « to consider », « prendre en considération »)
Si, tous permettent l’enrichissement de la langue, certains néologismes restent dans l’ère du temps longtemps… alors que d’autres deviennent vite passés de mode (par exemple, le mot « courriel » qui n’est plus tant utilisé).
Les linguistes distinguent aussi le néologisme objectif, naturel à l’évolution de la langue et utile, du néologisme subjectif, venant d’un auteur qui l’utilise comme figure de style pour développer sa nouvelle plume et son genre littéraire.
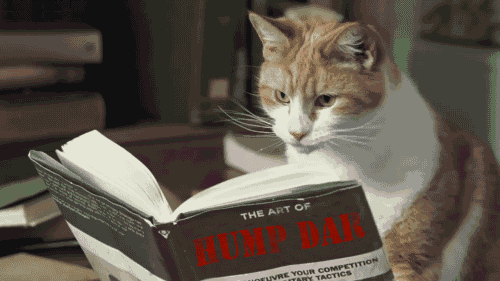
« Hapax » ⁉️
Un « hapax » est un néologisme formel subjectif. C’est un mot qui n’est utilisé qu’une seule fois, le plus souvent dans une œuvre littéraire – on ne peut lui trouver qu’une seule occurrence dans l’histoire. Il est créé par un auteur et n’a de sens que dans un seul texte. Ainsi, un « hapax » n’est pas amené à être employé une seconde fois. Ce terme a été créé par John Trapp en 1654.
Comment sont-ils créés ? 🧐
Chaque néologisme, qu’il soit formel ou sémantique, objectif ou subjectif, est formé différemment par son locuteur selon le contexte. On te l’a dit plus haut, il existe différentes sous-catégories à ces mots… Et on te parlait de leurs codes de formations.
➡️ Le changement de sens ou de construction (même exemple avec « industrie » ou « considérer »).
➡️ La dérivation : ajout d’un suffixe ou d’un préfixe (« grand » devient « grandiose »).
➡️ Le télescopage ou mot-valise : fusion de deux mots (« français » et « anglais » deviennent « franglais ») .
➡️ L’abrègement ou apocope, par troncation ou acronyme/sigle : réduction d’un mot enlevant une syllabe ou en ne gardant que les premières lettres (« cinéma » devient « ciné », « trouble obsessionnel compulsif » un « toc »).
➡️ La composition ou mot-composé : ajout de deux mots côte à côte (« vivre » et « ensemble » deviennent « vivre-ensemble »).
➡️ L’antonomase : désignation d’un nom commun par un nom propre ou inversement (« Don Juan » vient du célèbre séducteur, « Sopalin » de la marque d’essuie-tout…).
Certaines de ces formations sont aussi utilisées comme figures de styles, comme par exemple l’apocope ou l’antonomase. Tu le savais ?
Similitudes avec d’autres termes 🪧
On t’a parlé de son antonyme « archaïsme ». Mais, comme tous les mots de notre belle langue française, le mot « néologisme » a des synonymes et dérivés. Voyons ça ensemble. Ne t’en fais pas, tout va bien se passer !
Synonymes
🔁 La « Néosémie » – dérivé de « Polysémie », dont on t’a parlé plus haut –, est le fait de créer de nouveaux sens pour des lexies (unités du lexique) existantes, afin d’augmenter leur polysémie. Autrement dit, c’est un néologisme sémantique.

Dérivés
↪️ Un « Nécrologisme » est un néologisme devenu obsolète très rapidement, voire resté au stade d’hapax (« baladeur » est un nécrologisme).
↪️ Un « Paléologisme » est un néologisme qui revient du royaume des archaïsmes. En effet, c’est un mot ancien qui avait disparu de notre vocabulaire et qui revient comme néologisme à notre époque (exemples : « décisionnaire » et « générer » sont des paléologismes).
Besoin d’un prof particulier ? ✨
Nos profs sont là pour t’aider à progresser !
Contexte d’utilisation 🗒️
Les néologismes sont utiles pour plusieurs raisons : créativité des auteurs et poètes, société en mouvement, volonté de se mettre à la page… La langue évolue parce que notre réalité change sans cesse. Ainsi, avec l’arrivée de la technologie, de nombreux néologismes ont été créés. On te donne d’autres exemples tout de suite !
Exemples de néologismes, déjà dans le dictionnaire 🧑🎓
-
Apolitique
-
Vapoteuse
-
Activisme
-
Mondialisation
-
Photocopie
-
Pollueur
-
Médiathèque
-
Programmateur
-
Crush
-
Ghoster
-
Éco-anxiété
-
Hypermarché
-
Start-up
À savoir 🌈
L’écriture inclusive est instigatrice de nombreux néologismes, puisqu’elle propose une nouvelle utilisation du féminin/masculin dans la langue française. Le pronom « iel » (« they »), ajouté dans les dictionnaires cette année, vient ainsi de l’écriture inclusive.
À lire aussi
Découvre les nouveaux mots du dictionnaire 2023 !
Les néologismes en littérature 📖
On te l’a dit, de nombreux auteurs utilisent des néologismes (ou des hapax) dans leurs œuvres. La Team Sherpas te donne ici deux exemples !
À lire aussi
Apprends-en plus sur la littérature grâce à notre dossier sur les courants littéraires.
Tout d’abord, le discours du capitaine Haddock dans la BD Tintin est rempli de néologismes. Hergé a inventé de nombreux mots pour faire parler ce locuteur, volontairement vulgaire et pittoresque.
Mille millions de mille sabords !
Expression du Capitaine Haddock
Personnage de Tintin
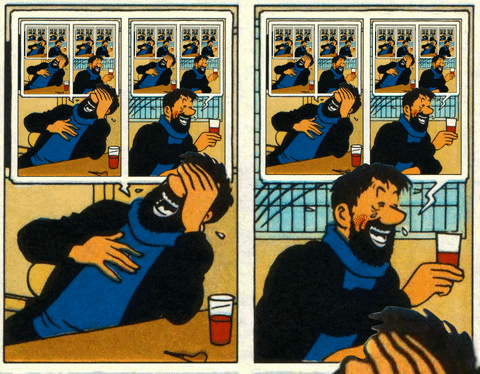
Ensuite, impossible de parler néologisme sans parler de l’auteur Céline ! Il a notamment été le premier à utiliser l’expression « blablater » en France…
D’autres expressions :
- « trouducteur », mot-valise de « trou du cul » et « traducteur »,
- « bouzillman », mot-valise de « bousiller » et « man » en anglais,
- « ménopauserie », néologisme à partir de « ménopause ».
Et voilà, tu sais maintenant tout sur les néologismes ! Ton professeur de français va être impressionné. Des remarques, de nouvelles envies d’articles ? On te laisse nous le dire en commentaire. 💭