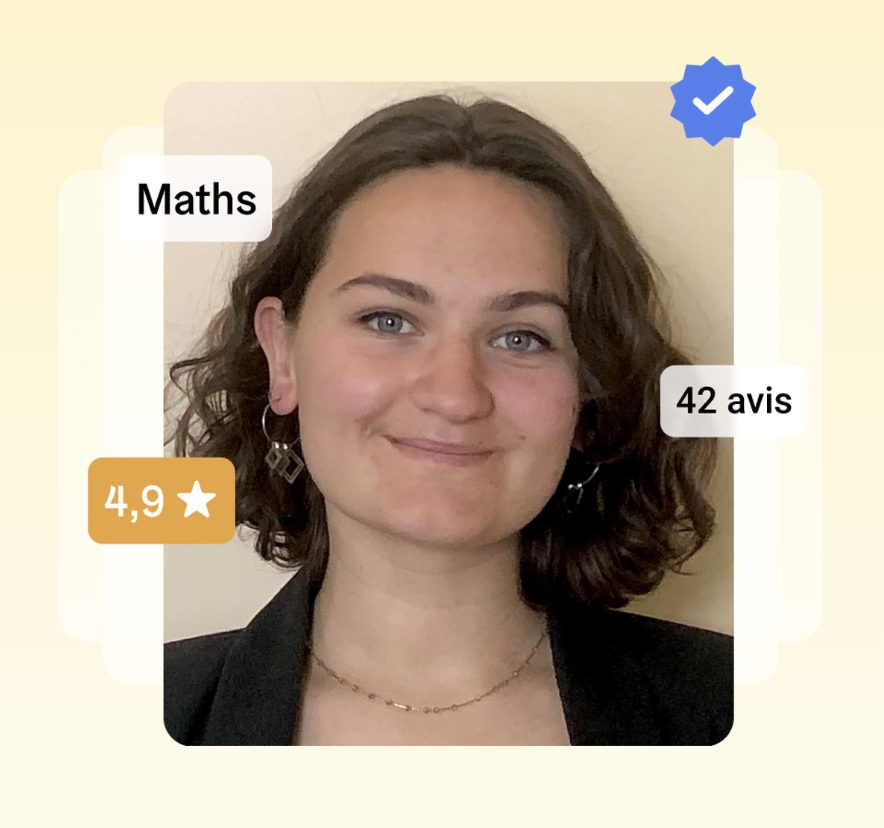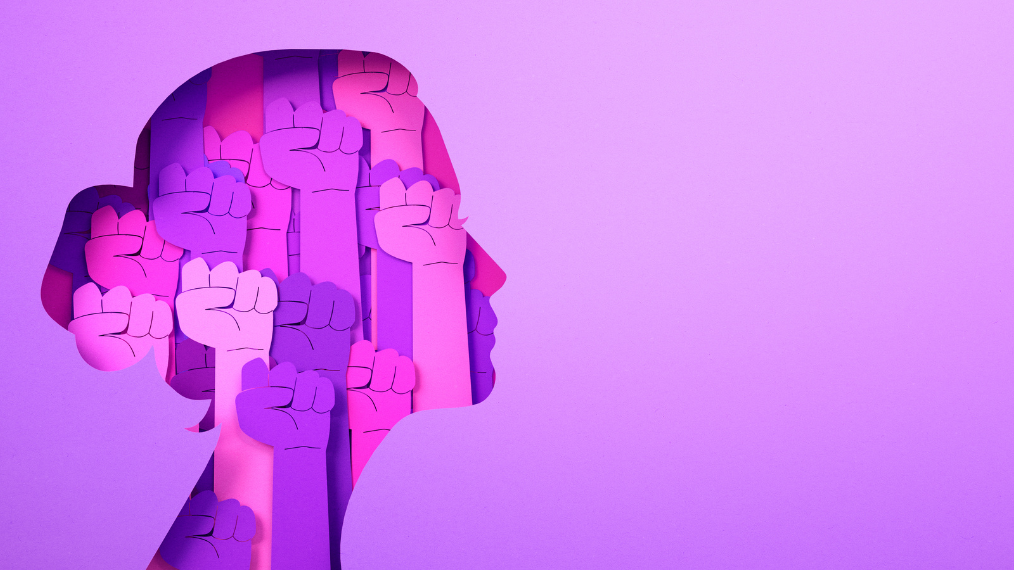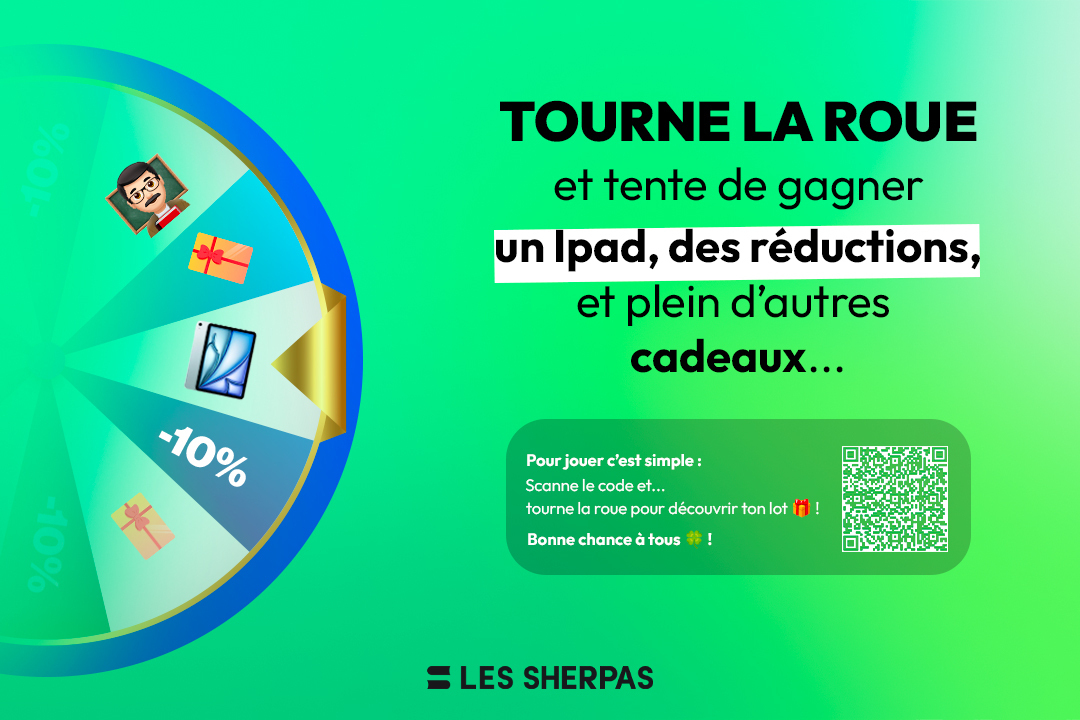Bien que cela évolue au fil du temps, dans les domaines scientifiques, les femmes ont toujours été sous-représentées par rapport à leurs homologues masculins. Et chez Les Sherpas, nous nous sommes interrogés à ce sujet.
Quelles sont les raisons de cette sous-représentation ? Pourquoi y a-t-il encore si peu de figures féminines dans les carrières scientifiques ? Comment la reconnaissance des femmes dans ce domaine a-t-elle évolué au cours des siècles ? Aujourd’hui, on répond à toutes les questions que tu peux te poser !
Alors, prêt à en apprendre davantage sur un sujet bien trop longtemps passé sous silence ? Promis, tu ne seras pas déçu du voyage ! 😉
Un constat chiffré 📊
Avant toute chose, commençons par une petite remise en contexte, avec un état des lieux de la place des femmes dans la science aujourd’hui. 👇
Les femmes peu présentes dans les formations scientifiques ? 🎓
Peut-être l’as-tu déjà remarqué, mais à l’école comme dans la vie professionnelle, les femmes occupent une place encore moins importante par rapport à celle de leurs homologues masculins.
Selon une étude réalisée sur l’état de l’enseignement supérieur, si 57% des femmes obtiennent un diplôme de l’enseignement supérieur pour 47% d’hommes, elles constituent seulement 43% des effectifs des formations scientifiques. Et après l’université, ce chiffre baisse drastiquement pour arriver à seulement 18% ! C’est tout de suite plus flagrant, n’est-ce pas ? 😅
L’écart est encore plus marqué dans certains domaines spécifiques : selon l’UNESCO, les femmes ne représentent que 12% des chercheurs en IA et 6% desdéveloppeurs de logiciels professionnels. Pourtant, ces domaines sont en plein essor et ce sont eux qui façonnent le monde de demain !
À lire aussi
Découvre aussi notre article sur l’histoire de l’évolution des droits des femmes !
Un décrochage progressif 🫤
Tu l’auras compris, ce déséquilibre que l’on peut observer dans ces formations ne fait que s’accentuer au fil des parcours académiques.
💡 Le savais-tu ?
Deux études de l’Institut des politiques publiques (IPP) ont montré que, contrairement aux idées reçues, les filles bénéficient d’une discrimination positive en sciences à différents stades de leur scolarité.
À l’École normale supérieure de Paris, les résultats montrent qu’à l’oral, les filles progressent nettement en mathématiques et en physique, ce qui leur permet de grimper en moyenne de 10 places sur 100 candidats. Ce phénomène est également observé dans les matières littéraires, mais à l’inverse : ce sont cette fois les garçons qui sont avantagés.
Au collège, ces mêmes études ont montré que l’effet était similaire. Lorsqu’une évaluation était anonymisée, les garçons obtennaient de meilleurs résultats. Mais lorsque les enseignants attribuaient eux-mêmes les notes, les filles étaient mieux notées, avec un écart moyen de +6 % en mathématiques.
Ces conclusions ont remis en question l’idée selon laquelle les filles seraient pénalisées en sciences. Pourtant, comme on le verra tout à l’heure, elles restent sous-représentées dans ces filières !
En réalité, ce phénomène s’explique notamment par un manque de représentation dans les domaines de recherche et de développement. En 2021, selon une étude réalisée sur l’état de la recherche sur l’état de la recherche, les femmes ne constituent que 34 % des personnels de recherche en France. À l’échelle mondiale, les données de l’Institut de Statistique de l’UNESCO (ISU) indiquent que moins de 30 % des chercheurs sont des femmes.
Ton premier cours particulier est offert ! 🎁
Nos profs sont passés par les meilleures écoles et universités.
Les femmes dans la recherche et les postes à responsabilité 🏛️
Ce plafond de verre est d’autant plus visible dans les carrières scientifiques. Si les femmes sont de plus en plus nombreuses à poursuivre des études dans ces domaines, leur présence, quant à elle, diminue drastiquement au fil de leur carrière. On pourrait penser que les choses s’améliorent avec le temps, et c’est vrai… Enfin, en partie !
Un plafond de verre, késako ? 🤔
Le plafond de verre désigne le fait que, dans une structure hiérarchique, les niveaux supérieurs sont rarement accessibles à certaines catégories de personnes, essentiellement en raison de mépris de classe. Dans ce cas précis, cela signifie que les femmes peuvent progresser dans la hiérarchie de l’entreprise, mais seulement jusqu’à un certain niveau. Résultat : elles sont en grande partie absentes du sommet de la hiérarchie.
On l’a vu tout à l’heure, aujourd’hui, les étudiantes sont presque aussi nombreuses que leurs homologues masculins en licence de sciences. Mais plus le niveau d’étude s’élève, plus elles disparaissent.
🔢 Quelques chiffres clés
D’après une étude faite sur la parité dans la recherche, en 2021, en France, 671 500 personnes (en personnes physiques) ont participé aux activités de R&D (Recherche et Développementà. Parmi cet effectif, 228 200 étaient des femmes, ce qui représente seulement 34 % du personnel de recherche et de développement. On sait, lorsque l’on compare, c’est peu…
Autrement dit, plus on monte dans la hiérarchie scientifique, plus les femmes se font rares. Cela en dit long sur la place des femmes dans la science et de manière plus générale dans la hiérarchie aujourd’hui, n’est-ce pas ?
🔢 Quelques chiffres clés
Selon une étude de l’INSEE réalisée en 2019, en Occitanie, dans le secteur privé, les femmes représentent 39 % des chefs d’entreprises (dirigeants salariés et non-salariés). Et lorsqu’il s’agit des niveaux hiérarchiques juste inférieurs, aux postes de directeurs et cadres des grandes entreprises, leur place est encore moindre, puisqu’elle atteint 23 %.
Pourquoi les filles se détournent-elles des sciences ? 🤔
Si les femmes sont, aujourd’hui encore, sous-représentées dans les domaines des sciences, c’est loin d’être anodin. Eh oui, derrière ces chiffres se cachent des décennies d’idées reçues, de biais inconscients et de freins structurels qui limitent l’attrait des sciences pour les jeunes filles. Ça te paraît flou ? Pas de panique, on t’explique tout ça ! 👇
Des stéréotypes ancrés dès l’enfance 🧸
Depuis notre plus jeune âge, nous ne recevons pas les mêmes encouragements en matière d’orientation si nous sommes des filles, ou des garçons. Dans le cas des sciences, elles ont trop souvent été perçues comme un domaine “masculin”, où il faut être rationnel, logique et compétitif. Des qualificatifs qui, selon de nombreux stéréotypes de genre, ont longtemps été attribués aux hommes… On sait, ces réflexions peuvent sembler venir d’un autre âge, et pourtant, c’est un système de pensée qui reste très ancré, malgré les avancées.
Les stéréotypes de genre, késako ? 🤔
Pour faire simple, un stéréotype de genre est une opinion généralisée ou un préjugé vis-à-vis des attributs ou des caractéristiques que les femmes et les hommes ont ou devraient avoir.
Par exemple, dans notre enfance, le fait que les kits de construction et les jeux STEM (sciences, technologies, ingénierie et maths) étaient souvent associés aux garçons, tandis que les poupées et les jeux créatifs étaient plus souvent proposés aux filles est un stéréotype de genre !
À lire aussi
Envie d’en savoir plus sur le concept de parité ?
Les chiffres sont souvent plus révélateurs que de longs discours, alors laisse-nous t’en présenter quelques-uns. Une étude Ipsos a récemment révélé que seulement 33% des filles reçoivent un soutien familial pour s’orienter vers les métiers du numérique et des sciences. Si l’on compare avec les garçons, ce chiffre atteint 66%. Tu remarqueras une différence de taille !
Et ce conditionnement joue un rôle important dans la perception des sciences chez les jeunes filles. C’est aussi lui qui peut influencer leurs choix d’orientation, et ce, dès le collège et le lycée !
Une orientation influencée par des choix multiples 🧐
Pour comprendre cette sous-représentation des femmes dans certains milieux, nous avons interrogé une professeure et lui avons posé la question. Voici l’une des réponses qu’elle a pu nous donner :
J’ai souvent pu constater, parmi mes élèves lycéens, que si les garçons s’intéressaient aux sciences, alors seules les sciences comptaient pour eux. Au contraire de mes élèves filles qui pouvaient avoir un grand intérêt pour les sciences, mais également pour la littérature, la musique, l’art, etc. Lors du choix des filières et du projet d’études, les garçons n’ont finalement souvent qu’une option selon leur goût, à la différence des filles qui hésitent entre 2 à 3 options avec de grandes facilités dans chacune d’elles. Parfois, elles choisissent donc plutôt une autre filière et ne vont garder les sciences que pour le plaisir de la lecture et des loisirs.
Résultat de ce processus ? Il peut arriver aux filles de délaisser les sciences, non pas par désintérêt, mais plutôt parce qu’elles ont davantage de choix que les garçons. Malheureusement, cette polyvalence peut aussi être perçue comme un manque de spécialisation dans le monde professionnel. Ce qui n’est pas forcément le cas !
Le manque de modèles féminins 🤷♀️
Aujourd’hui, en science, les femmes sont de plus en plus mises en avant, que ce soit dans les programmes scolaires, ou dans les médias. Mais lorsque l’on compare cela à la mise en lumière de leurs homologues masculins, on y voit bien souvent une différence flagrante.
💡 Le savais-tu ?
En Australie, une seule femme scientifique est mentionnée dans les manuels scolaires des lycées : Rosalind Franklin. Et encore… Selon The Guardian, son nom est uniquement cité dans les écoles de certains états et territoires australiens !
Rappelle-toi de tes cours de sciences du collège ou du lycée, durant lesquels il pouvait t’arriver d’étudier les figures historiques qui ont façonné les connaissances scientifiques d’aujourd’hui. Certes, tu as sûrement déjà entendu parler de Marie Curie, qui a décroché le prix Nobel de chimie pour avoir réussi à isoler un gramme de radium, ou encore de Rosalind Franklin, dont la découverte de l’ADN a marqué l’histoire. Mais en dehors de ces quelques noms, combien de femmes scientifiques pourrais-tu citer spontanément sur la simple base des cours que tu as pu recevoir ?
À l’inverse, les figures masculines ont toujours été omniprésentes. Newton, Einstein, Darwin, Pasteur, Galilée… Tant de noms qui n’ont eu de cesse d’être mis en avant lorsque l’on abordait les grandes découvertes scientifiques, renforçant l’idée que les découvertes majeures ont été faites par des hommes. Bien que notre société évolue et que les femmes scientifiques sont de plus en plus mises en avant (comme nous le verrons tout à l’heure 😉), c’est ce manque d’équilibre qui contribue à perpétuer le stéréotype selon lequel les sciences seraient une “affaire d’hommes”.
Besoin d’un prof particulier ? ✨
Nos profs sont là pour t’aider à progresser !
Les avancées pour plus d’inclusivité 🫂
Fort heureusement, la sous-représentation des femmes dans les sciences est une problématique qui est de plus en plus prise en compte aujourd’hui. De nombreuses initiatives et dispositifs émergent pour encourager les jeunes filles à s’orienter vers des domaines scientifiques, et pour arrêter d’invisibiliser les femmes scientifiques. On t’explique tout ça. 👇
Des programmes éducatifs instaurés 🧑🎓
Aujourd’hui, l’un des principaux leviers que nous avons pour élever les consciences, c’est l’éducation. Pour favoriser la présence des femmes dans les domaines scientifiques, et surtout arrêter les préjugés auxquels elles peuvent faire face, il faut donc également en passer par là. C’est dans cette optique que de nombreuses associations ont vu le jour, pour déconstruire les stéréotypes sur le sujet, et pour ouvrir davantage les milieux scientifiques aux femmes.
En France, par exemple, il y a des associations comme “Femmes et sciences” (facile à retenir, non ? 😉) dont le but est justement d’inciter les jeunes filles à s’engager dans des formations scientifiques et techniques, de favoriser la promotion des femmes engagées dans des carrières scientifiques, mais aussi d’améliorer la visibilité des femmes scientifiques.
Mais elle n’est pas la seule ! Puisqu’il y a aussi “Elles bougent”, une association qui vise quant à elle à susciter des vocations féminines pour les métiers d’ingénieurs dans l’aéronautique, le spatial, ou encore le transport ferroviaire. Un exemple concret d’une de leur initiative ? L’association a réalisé des interventions dans plusieurs lycées pour valoriser les carrières scientifiques à destination des jeunes filles. En 2023, ça a notamment été le cas du Lycée Marie Curie.
Une meilleure mise en avant des femmes scientifiques 🔬
Si nous t’avons parlé du manque d’équilibre entre les figures féminines et masculines mises en avant dans les domaines scientifiques, il n’en reste pas moins que notre monde évolue. Eh oui, grâce aux nombreuses initiatives mises en place ces dernières années, les femmes scientifiques ont de plus en plus de visibilité.
Pour te donner un exemple, Pénélope Bagieu, une illustratrice française, a créé un livre intitulé Les Culottées, qui met en avant des portraits de femmes inspirantes qui ont “lutté contre vents et marées pour faire ce qu’elles avaient à faire”. C’est ce genre d’œuvre qui contribue à rendre visible , tous milieux confondus.
Il y a également des programmes comme celui L’Oréal – UNESCO Pour les femmes et la science qui permettent justement de mettre en avant les femmes scientifiques d’aujourd’hui.
Le programme L’Oréal – UNESCO Pour les femmes et la science, késako ? 🤔
Ce programme est un partenariat qui a été créé en 1998 entre L’Oréal et l’UNESCO dans le but de promouvoir la place des femmes dans les sciences.
Pour te donner un exemple, l’un des volets distingue chaque année, avec un grand prix, cinq chercheuses, une par grande région (Afrique et États arabes, Amérique latine, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe).
Des modèles féminins de plus en plus présents 💁♀️
En plus de toutes les initiatives mises en place pour améliorer la visibilité des femmes en sciences, de plus en plus de chercheuses s’imposent comme des modèles inspirants pour les générations futures. Voici cinq femmes scientifiques qui, par leur travaux et leur parcours, participent à façonner le monde de demain :
-
Nina Tendon : ingénieure biomédicale et fondatrice d’EpiBone, elle a révolutionné la reconstruction osseuse en développant une méthode qui permettait de cultiver des os en laboratoire à partir de cellules souches de patients. On sait, ça paraît un peu flou expliqué comme ça, mais son travail a notamment permis d’obtenir de réduire les risques de rejet en cas de greffe, et d’ouvrir la voie à des traitements plus efficaces en médecine régénérative.
-
Tiera Guinn : ingénieur aérospatiale américaine, elle a contribué au développement du Space Launch System de la NASA, un programme important pour l’exploration spatiale et les futures missions vers mars.
-
Hamilton Bennett : Directrice principale de l’accès aux vaccins et des partenariats chez Moderna, elle a joué un rôle important dans le développement du vaccin à ARN messager contre la Covid-19.
-
Françoise Barré-Sionoussi : virologue française, elle est connue pour avoir découvert le virus du VIH, une avancée qui lui a notamment valu le prix Nobel de Médecine en 2008. Eh oui, rien que ça ! Aujourd’hui, en plus d’être engagée dans la lutte contre le sida, elle préside également le Comité analyse recherche et expertise (CARE) contre la Covid-19 en France.
-
Bérengère Dubrulle : physicienne et chercheuse au CNRS, elle s’est beaucoup intéressée aux turbulences atmosphériques et astrophysiques. Et en 2022, elle a été nommée “Femme scientifique de l’année” par l’Académie des sciences grâce à ses travaux sur les dynamiques des fluides, et leur impact sur notre compréhension du climat et de l’univers. Plutôt sympa, non ?
Bref, tu l’auras compris, les femmes ont toujours eu leur place dans les sciences. Aujourd’hui, grâce aux efforts de sensibilisation, aux initiatives mises en place, et aux nombreuses figures féminines inspirantes, les mentalités évoluent et permettent à de plus en plus de femmes d’exceller dans ces domaines.
Alors, que tu sois un étudiant ou une étudiante, souviens-toi : la science appartient à tout le monde. Et qui sait ? Peut-être que la prochaine grande découverte viendra de toi !